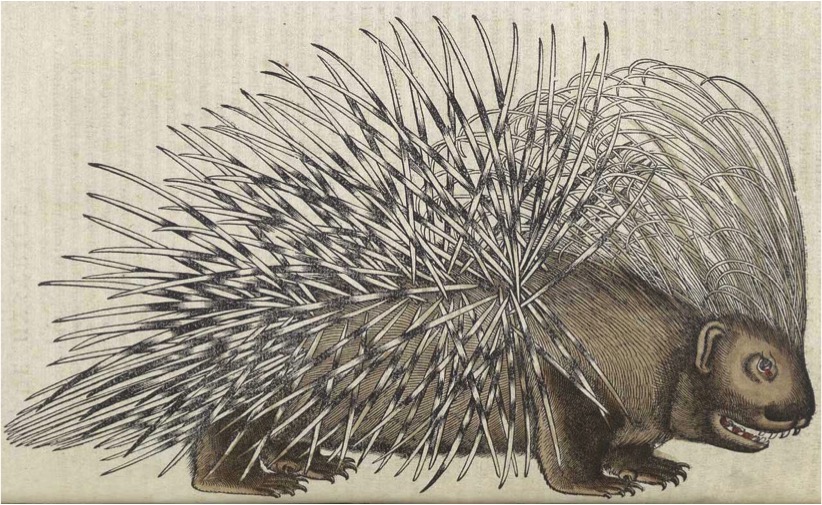I. Présentation générale du projet
II. Plan de recherche
1. Travaux existants : un point aveugle dans un champ émergeant
2. Axes et objectifs généraux
3. Trois études de cas
III. L’équipe
I. Présentation générale du projet
Ce projet entend examiner les relations entre trois termes : homme, animal et plante, que l’histoire culturelle s’est longtemps contentée d’analyser de manière duelle en privilégiant le couple homme-animal. Dans l’Europe de la première Modernité, des représentations discursives sensibles aux interactions dynamiques entre ces trois communautés en ont construit une histoire partagée. L’étudier, c’est renouer avec le sens premier du terme « communication », qui entre au début du XIVe siècle dans la langue française avec le sens général de « manière d’être ensemble, d’être en commun », avant de prendre à partir du XVIe siècle ses acceptions modernes. En effet, la réflexion sur les échanges, les communications ontologiques qui brouillent les frontières entre les espèces fut à cette époque indissociable de la question de la communication – au sens interdiscursif du terme – entre leurs membres. Tout en s’intéressant au premier chef à la production de textes littéraires, le projet s’inscrit également dans l’anthropologie culturelle et l’histoire des sciences, l’ethnologie, la botanique ou la zoologie, car l’interrogation théorique des frontières ontologiques implique des aspects géographiques (en particulier pour le corpus des récits de voyage), linguistiques (latin vs. vernaculaire), formels et génériques, à un moment où les poétiques ne sont pas encore complètement stabilisées – interdisciplinarité d’autant plus nécessaire que les savoirs « scientifiques » de l’époque s’intègrent à des régimes d’écriture très différents des nôtres.
Pour mesurer la complexité des échanges entre les règnes mais aussi entre les discours, tels qu’ils se déploient de la fin du XVe au second tiers du XVIIe siècle, on explore un corpus pluridisciplinaire, marqué par l’hétérogénéité et des emprunts réciproques : production médicale, juridique et théologique, littérature agronomique et cynégétique, herbiers, récits de voyage, poésie de la nature, fictions romanesques, nouvelles, traités de poétique, etc. Les ouvrages, français ou latins, publiés en France, sont au cœur du projet, enrichis d’incursions dans l’ensemble des littératures européennes.
Ce projet relève donc d’une archéologie de la pensée occidentale du vivant ; il rejoint les courants actuels qui s’attachent à complexifier la grande Histoire de cette pensée, et elle entend souligner ses fondements littéraires, l’enjeu étant de reconstituer un modèle oublié de réflexion sur la communauté entre humanité et autres formes de vie.
II. Plan de recherche
Selon Descola (2005), le « schème naturaliste » qui caractérise l’Occident n’irait désormais « plus de soi » – ce schème ségrégationniste opérant le grand partage entre le monde des sujets humains et celui des objets non-humains, qu’Aristote, puis le christianisme, auraient contribué à façonner avant son avènement à l’âge classique. Or ce grand récit, qui retrace l’instauration d’un ordre puis sa mise en crise contemporaine, omet de penser des conflits plus anciens qui opposent au principe d’un étagement entre les règnes une conception plus poreuse des frontières du vivant. La période allant de la fin du XVe siècle aux années 1670 favorise en effet une interrogation intense et aujourd’hui oubliée sur les relations mutuelles entre homme, animal et plante, avec une attention marquée pour les brouillages des frontières entre ces catégories et leurs conséquences anthropologiques.
La fin du Moyen Âge voit l’effritement progressif des systèmes hiérarchisés hérités de la psychologie aristotélicienne (les qualités propres aux âmes végétative, sensitive et intellective s’échelonnent entre ces mêmes classes) et de la Bible (dans la Genèse, Dieu crée d’abord les plantes, puis les animaux, puis l’homme). Cette évolution intellectuelle, couplée à la naissance de l’imprimerie et à l’élargissement des horizons géographiques, marque l’entrée de l’Europe dans une nouvelle ère. La critique de l’anthropocentrisme trouve alors des développements inédits dans la culture savante : le décentrement s’opère non seulement à travers la mise en valeur de l’intelligence animale, mais aussi par la promotion de la pensée et de la sensibilité végétales. Le problème, philosophique, est aussi religieux. La revalorisation des âmes inférieures se situe du côté de la dissidence doctrinale. Des formes de vie troubles, déjà connues ou non au Moyen Âge, favorisent une mise en question des procédures classificatoires de la philosophie naturelle, comme de la hiérarchie chrétienne du vivant.
Le XVIIe siècle, plus encore que la période qui précède, est marqué par le refus virulent de suivre la voie tracée par Aristote et la Bible. Descartes élimine ce qu’Aristote appelait âmes végétatives et sensitives, réintroduisant une distinction extrêmement ferme entre les règnes. Pourtant le trouble demeure car la constellation « libertine » ne s’intéresse pas à ce qui, chez l’homme, lui serait propre, l’ « âme pensante », mais à ce qu’il partage avec animaux et avec végétaux. Notre enquête prendra donc pour terminus post quem la fin des années 1670, moment clé de la réfutation du Discours de la méthode, lorsque La Fontaine, qui fréquente ces libertins, met en cause la thèse cartésienne des animaux-machines dans le discours à Mme de Sablière (Fables, 1678), et moment où l’essor d’une nouvelle pratique, la dissection des plantes, établit une correspondance entre la structure anatomique végétale et animale (Malpighi, Anatome Plantarum, 1675‑1679). Désormais en effet, le jeu des correspondances repose moins sur la vieille cosmologie du macrocosme et du microcosme, et sur une interrogation à propos du langage, que sur des observations concrètes au microscope (Fournier, 1996), au moment même où s’achève la longue histoire des merveilles naturelles comme objets d’investigation privilégiés de l’élite culturelle européenne (Park et Daston, 1998). L’unité du vivant tend à devenir une question de biologie.
Il s’agit de mettre en valeur une période de trouble dans le vivant, où les frontières entre les règnes sont en constant déplacement et réélaboration, qui génère à son tour un trouble dans la langue.
a) Il y a trouble dans le vivant car l’animal et le végétal menacent la prééminence ontologique de l’homme. « Qui sçait si en nous aussi il ne manque pas encore un, deux, trois et plusieurs autres sens ? » demande Montaigne, combattant le mépris pour l’animal. « Qui sait si les plantes ne possèdent pas quelque sens inouï, inconnu de l’homme ? », renchérit La Brosse (1628), fondateur du Jardin des Plantes. L’Europe des XVIe et XVIIesiècles connaît ainsi de nombreuses tentatives de reconfiguration ontologique. Des penseurs hétérodoxes bouleversent la hiérarchie héritée d’Aristote pour établir des connivences transversales entre les règnes. Marqué par l’héritage néo-platonicien, leur goût pour les créatures fabuleuses et insolites célèbre la prodigalité de Nature plutôt que son agencement ordonné (Mazauric, 1999). Le fameux « zoophyte » ou animal-plante joue dans ces débats un rôle de ferment épistémologique. À mi-chemin entre le végétal et l’animal, cette créature constitue une catégorie d’êtres, déjà identifiée par Aristote, mais significativement enrichie entre la fin du XVIe et le milieu du XVIIe siècle, âge d’or scientifique des merveilles naturelles. Quant à la célèbre mandragore, « homme en la figure exterieure et plante en la forme interieure » (Renaudot, 1641), elle dessine un territoire de l’hybridité à part ; cet anthropophyte mine le principe de discontinuité hiérarchique éloignant flore et humanité. Comment situer la plante-homoncule par rapport à l’animal ? Même les êtres les plus familiers révèlent des dons étonnants. L’ataraxie végétale est un leurre et les plantes subissent leur lot d’affects perturbateurs. L’exception se dégage alors de son statut marginal pour suggérer un ordre général de l’animal ou du végétal et distendre les cadres catégoriels en vigueur.
b) Il y a trouble dans la langue car ces créatures perturbent les textes qui tentent de les saisir dans une taxinomie ou un récit. Certes, le discours sur l’animal et la plante dans l’Europe pré-moderne s’inscrit dans un horizon essentiellement anthropologique : discours d’homme, il a bien souvent pour véritable objet l’homme lui‑même, tel qu’il se conçoit en opposition ou en accord avec les deux autres règnes (Gontier, 1998). Mais il ne sort pas indemne de cette confrontation qui résonne avec d’autres bouleversements d’ordre discursif : concurrence du français et du latin comme langues de science, essor de genres hybrides, où formes littéraires et matériau zoologique et botanique se rencontrent. Quand il s’agit de « toucher » le monde naturel par le langage, animal et plante résistent à cette médiatisation. Le projet référentiel se heurte à un obstacle majeur, similaire à celui de la littérature viatique : « l’hétérogénéité du texte et du monde, puisqu’il incombe au voyageur de faire entrer le désordre proliférant du réel dans les structures clairement délimitées d’une construction textuelle » (Tinguely, 2006). En outrepassant les limites de l’âme végétative et sensitive, animaux et végétaux introduisent une « inquiétude et une ouverture dans la langue » (Marchal, 2007), ainsi invitée à dépasser ses structures propres. Le débordement des catégories figées de l’être met à l’épreuve les formes régulées du discours, forçant à les redéfinir et à les réinventer. Aussi l’articulation entre élaboration langagière et trouble entre les règnes forme‑t‑elle le nœud de notre enquête.
II. 1. Travaux existants : un point aveugle dans un champ émergeant
En contrepoint à des discours critiques qui placent l’homme toujours plus au centre du monde de la Renaissance, et proposent une lecture par trop caricaturale de la première Modernité, la recherche sur les bêtes et l’animalité constitue un champ en plein développement, que commencent tout juste à concurrencer les travaux consacrées au végétal. Notre projet se propose d’articuler ces deux domaines, dont aucune étude n’a encore tenté de penser la solidarité et la relation commune à l’humain.
Homme et animal
D’abord apparues dans le domaine anglo-saxon, les animal studies ont peu à peu conquis l’ensemble du monde universitaire et quasiment la totalité des disciplines. Traversées par une même dynamique que celle des minor studies, les études sur l’animal bénéficient d’un développement exponentiel et souffrent cependant de ce foisonnement1. Nous devons donc veiller à ce que nos définitions et les réalités que nous désignons sous certains concepts – comme celui d’animal – soient stables et permettent un dialogue interdisciplinaire fécond.
Notre perspective retiendra plus particulièrement les travaux qui concernent l’animal comme figure ou motif de la littérature. Jusqu’ici, ces derniers ont surtout eu lieu en littérature comparée et pour des périodes ultérieures à la nôtre : un numéro de la revue du Dix-huitième siècle, « L’animal des Lumières » (no 42, 2010), consacre plusieurs articles à ce motif, tandis qu’une synthèse récente fait le point sur la présence animale dans la littérature contemporaine (Desblache, 2006) ; le programme ANR intitulé « Animaux et animalité dans la littérature de langue française (xxe-xxie siècles) » vient de favoriser la diffusion scientifique de ces questions (http://animots.hypotheses.org/). La place de la narration de langue française dans la construction des rapports qu’entretiennent hommes et animaux demeure une question à traiter pour les XVIe et XVIIe siècles.
Pour cette période, seules deux thèses, monographiques et en cours, ont pour sujet les animaux : Le statut éthique de l’animal dans les Essais de Michel de Montaigne par Sabine Bonamy (2006), et L’humanisme rabelaisien à l’épreuve de la bestialité : enjeux esthétiques et éthiques d’un imaginaire animal à la Renaissance par Louise Million (2008). S’y ajoutent la thèse de M. Jourde, qui se consacre aux oiseaux (1998), certains travaux comme ceux de M. Marrache-Gouraud (2008) ou de F. Tinguely (2008), et un colloque consacré à L’animal sauvage à la Renaissance (2007). Mais les synthèses sur la question font défaut. L’exploration littéraire des liens entre flore, faune et humanité n’a donné lieu – à l’exception de la thèse de Jean Céard sur les prodiges (1977) – à aucune enquête conséquente.
______________________________
- Pour s’en tenir à quelques disciplines et sans souci d’exhaustivité, les rapports entre homme et animal, tels que les a pensés Delort (1984), relèvent de multiples champs : psychologie (Cyrulnik, 1998), éthique et droit (Jeangène Vilmer, 2008), médecine (Tassin, 2007), ethnologie (Lorenz, 1970), politique (Regan, 1985), philosophie (Fontenay, 1998 ; Derrida, 2006), histoire (Baratay, 2012), littérature et histoire des représentations (Surya, 2004 ; Pastoureau, 2012).
Homme et végétal
À l’inverse des études sur l’animal, le végétal est longtemps demeuré un champ d’investigation inexploré. Rejetées avec Aristote dans les limbes de l’insensible, les plantes ne semblent guère inspirer l’histoire culturelle (Ingensiep, 2001 ; Boutroue, 2002). L’histoire de la biologie n’accorderait pas plus de place à ces êtres rétifs aux projections anthropomorphes (Delaporte, 1979). Nombreux sont ceux qui ont dénoncé cette négligence (Hallé, 1999). Ainsi que l’écrit Lieutaghi (1991), « à Lascaux, déjà, on ne voit rien de végétal ; l’animal-roi semble occuper tout l’espace de dévotion […]. C’est seulement que la plante ne prête pas à gloire, qu’on ne la vainc pas dans les périls. Rien pour la mémoire des exploits ». Le terme « botanique » lui‑même provient de l’animal par son étymologie : boton, en grec ancien, désigne la bête d’un troupeau, botanè son fourrage. En définitive, la plante n’apparaît que comme l’expression inachevée de l’animal. L’analogie fondatrice entre ces deux règnes fut d’ailleurs « une arme à double tranchant » dans l’histoire de la botanique : féconde épistémologiquement, elle menace d’étouffer l’altérité du végétal en l’inféodant à l’étalon animal, risque signalé dès Théophraste (Arber, 1953 ; Atran, 1986).
Sur le plan philosophique également, le végétal s’est vu relégué au rang de tiers exclu, éclipsé par l’attention exclusive donnée au vaste débat sur la distinction entre animal et homme, question ancienne ranimée par la thèse cartésienne des animaux-machines. Alors que l’animalité peut mettre à l’épreuve la philosophie (Fontenay, 1998), il n’en serait rien de la végétalité dormante. Sans rendre justice aux aspects organiques de l’âme, pourtant primordiaux dans la philosophie naturelle, les travaux sur la psychologie renaissante se concentrent sur ses seuls attributs immatériels, l’intellect et l’immortalité, privilèges contestables de l’humanité (Park, 1988). Pichot (1993) soupçonne, avec raison, que l’héritage cartésien a longtemps pesé sur les sciences humaines. À l’évidence, le fait de cantonner les plantes dans un en-deçà du sentiment et de l’entendement les rend peu dignes d’une attention éthique et philosophique.
Or depuis quelques années, cette question a attiré l’attention des sciences humaines comme des sciences de la nature (Corbin, 2013 ; Jacquet et Hallé, 2013 ; L’Arbre ou la raison des arbres, 2013 ; journée jeunes chercheurs organisée en 2007 à l’Université Strasbourg–II sur « Le modèle végétal dans l’imaginaire contemporain »). Pour la période pré-moderne, l’intérêt s’est focalisé sur l’héritage des Métamorphoses d’Ovide (Mathieu-Castellani, 2012) ; l’horticulture et l’agriculture (Duport, 2002 ; Du ciel à la terre, 2009 ; colloque Manipulating Flora. Gardens as Laboratories in the Renaissance and Early Modern Europe, Bucarest, 2016) ; la botanique comme pratique savante (Le monde végétal. Médecine, botanique, symbolique, 2009 ; « Botanique et curiosité : les plantes curieuses », journée d’études organisée en 2008 par M. Marrache-Gouraud) ; ou la flore symbolique (Flore au paradis, 2004). Mais il n’existe aucun travail de synthèse sur les interactions entre l’homme et le végétal au‑delà de son rôle nourricier ou curatif.
En même temps, cette question s’est vue portée sur un plan légal et éthique. En Suisse, la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain a produit en avril 2008 un document intitulé La dignité de la créature dans le règne végétal qui attribue à la plante une « valeur morale » intrinsèque, au nom de laquelle elle doit être protégée (CENH, 2008). Cette déclaration des droits de la plante ne repose pas sur le postulat qu’elle serait dotée de raison (ratiocentrisme), ou de sensibilité (pathocentrisme), mais qu’elle serait vivante. En revanche, dans What a Plant Knows (2012), le biologiste Chamovitz établit des parallèles inédits entre la sensibilité humaine et celle des plantes, de surcroît douées de mémoire – voire de conscience. Une manière de mettre fin à ce que Schaeffer (2007) appelle « l’exception humaine » et de miner, en s’inscrivant au cœur des débats contemporains, une conception exclusivement anthropocentrique des modes et des possibilités d’être.
Notre projet permet donc d’aborder sous un angle neuf la question des rapports entre l’homme et l’animal (qui fera l’objet du 141e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques en 2016) tout en participant aux développements de la recherche sur le statut culturel de la plante (voir le carnet « Cultures du végétal », https://vegetal.hypotheses.org). L’originalité de l’enquête vise à mettre au jour une dynamique triangulaire où les rapports d’identité et d’altérité liant les trois règnes reposent sur des jeux d’alliance et d’opposition constamment redéfinis. De par la diversité des corpus envisagés, le projet dialogue étroitement avec les études sur les interfaces entre science et littérature. Il soulève aussi des enjeux éthiques qui trouvent des échos croissants dans le domaine de l’ecocriticism : comment, dans l’Europe de la première Modernité, se distribuent, pour les animaux et les plantes, une valeur instrumentale (leur utilité pour l’être humain) et une valeur indépendante d’une finalité d’usage ? Cette question est du reste adossée à la question philosophique plus large de l’appartenance de l’homme à la nature : altérité, ou continuité, voire identité ? Enfin, l’enquête recouvrira une dimension esthétique en interrogeant la puissance de formalisation des modèles du vivant – objet du dernier sous-projet.
Modélisations du discours
Ici, le relatif primat donné à l’animal et à l’humain sur le végétal – évoqué précédemment – s’inverse. Un certain nombre de travaux se sont intéressés à la manière dont le végétal structurait l’imaginaire mimétique à la Renaissance (Galland-Hallyn, 1994 ; Deremetz, 1998), en étudiant notamment comment le développement de l’art des jardins d’une part (Simonin, 1987), des traités d’agriculture d’autre part (Duport, 1995, 2002), avait contribué à l’essor considérable et à la réactivation d’un paradigme métaphorique légué par l’époque antique, servant à emblématiser la langue ou encore la création littéraire. En revanche, il n’existe guère, sauf dans le cadre d’études ponctuelles sur tel ou tel motif – l’écrivain en abeille (Rouget, 2000 ; Fumaroli, 2001), le poète en rossignol (Jourde, 2000), l’artiste en araignée (Ballestra-Puech, 2006) –, d’enquêtes portant sur les enjeux et les fonctions du paradigme animalier et du paradigme humain pour décrire et évaluer le fait linguistique, littéraire ou poétique (voir toutefois Jourde, 1998, thèse non publiée). Or, c’est pourtant assurément dans la confrontation des paradigmes, ou la substitution progressive de l’un à l’autre que l’on est amené à percevoir les enjeux de ces désignations et à saisir les évolutions les plus marquantes. Ainsi, dans le micro-système du lexique métrique, c’est avec la rénovation de la poésie qui a lieu en France autour des années 1540‑1550, qu’est promu, au détriment d’analogies botaniques et animales souvent alors en perte de vitesse, un langage du corps humain dotant le poème et le vers d’un cœur, soumis à des « diastoles » (diérèses), comme d’un sexe (masculin ou féminin).
L’objectif d’ensemble est de restaurer une vision plus globale des échanges redéfinissant constamment les frontières du vivant, du sensible et du pensant, et d’examiner le rôle des ressorts du littéraire dans ce processus, sur une période qui correspond à d’importantes remises en question des ordres ontologiques traditionnels, et plus particulièrement d’Aristote. Un espace de réflexion commun à tous les membres est assuré par un séminaire régulier et un colloque final. Cette enquête est complétée par trois sous-projets. L’un permettra de mettre en regard les modèles humain, animal et végétal, tandis que les deux autres se concentreront respectivement sur le rapport entre l’animal et l’homme, et la plante et l’homme, tout en gardant en perspective le tiers règne ainsi « exclu » : on prendra en compte, notamment avec l’édition critique du traité sur la mandragore de Catelan, les êtres intermédiaires, zoophytes, anthropophytes, anthropozoon, qui brouillent les partages catégoriels, ou les transformations d’un règne en un autre (par exemple les bernacles, oiseaux qu’on pensait issus du bois des épaves). Notre hypothèse commune sera qu’à un moment où l’imprimerie apporte des moyens inédits pour gérer, stocker et classer un nombre considérable d’informations sur le monde naturel (Blair, 2010), le vivant apparaît précisément comme un lieu en perpétuelle mutation, susceptible de résister aux tentatives de classer les espèces.
II. 2. Axes et objectifs généraux
La carte du vivant
Les modalités de la relation entre homme, animal et plante se trouvent largement déterminées par l’héritage aristotélicien et ses commentaires grecs, latins et arabes dans la philosophie et l’histoire naturelle de la Renaissance (voir Brancher, 2015). C’est donc par rapport à ce modèle qu’il faut mesurer écarts et tentatives d’émancipation. Le schéma de base demeure remarquablement stable : les plantes jouissent seulement d’une âme végétative, qui leur permet de se nourrir, de croître et de se reproduire. L’âme sensible, qui concerne l’appétit, le désir et la mobilité, est réservée aux hommes et aux bêtes. Enfin, l’âme raisonnable est le privilège de l’humanité. Véritable trame du vivant, cette échelle des êtres ou scala naturae dessine un mouvement vers la perfection où le végétal et l’animal sont compris dans un rapport à la fois d’identité et d’altérité l’un vis‑à‑vis de l’autre, ainsi qu’avec l’humain. Dans son introduction aux Catégories d’Aristote, l’Isagoge, Porphyre présente cette doctrine sous forme d’un arbre qui allait porter son nom et structurer la pensée occidentale au moins jusqu’au XVIIIe siècle.
L’anthropologie chrétienne s’est aisément accommodée de cet échelonnement des êtres, tout en s’efforçant de lui associer une définition dualiste de l’homme. Il s’agissait à la fois de souligner ses privilèges par rapport aux autres vivants (image de Dieu, il jouit seul de cette faculté intellective qui lui assure l’immortalité), mais aussi la distance qui le sépare de son Créateur et le rapproche des animaux et des végétaux, représentant les parties inférieures de l’homme. Investie d’une signification allégorique et morale, la chaîne des êtres pouvait en effet servir à figurer cette ambivalence de la condition humaine, qui est la conséquence du péché originel. Cet ordre physico-moral est structuré par la gradation augustinienne entre esse, vivere, sentire et intelligere, qui déconsidère la vie organique au profit de la pensée rationnelle. Selon ce système d’emboîtement « encaptique », l’homme est avec les pierres, vit avec les plantes, sent avec les animaux et pense tout seul dans le monde sublunaire, inspiré par Dieu et les Anges. Dans le Liber de sapiente de Bovelles (Paris, 1510), l’homme raisonnable occupe le sommet éthique et ontologique d’où peut dévaler le pécheur. Il tombera à l’échelle sensitive des animaux par sa luxure, au niveau végétal par sa gloutonnerie, à l’état de pierre par son acédie.
À d’autres égards, la réévaluation chrétienne de l’axiologie antique en subvertit la portée. La plante peut à l’inverse se muer en modèle éthique. Ainsi, lorsque l’homme veut se définir a contrario de l’animal, il jouera la plante contre la bête, la candeur de l’âme végétative contre les concupiscences de l’âme sensitive (qui est le privilège ambigu des êtres sexués), le temps paradisiaque contre celui de la chute. À l’inverse, l’animal peut prendre la dimension d’un modèle christique, comme le pélican chez Du Bartas (1584).
Mais nombre de savants de la Renaissance préfèrent réserver à l’homme toute parenté divine : plutôt que de posséder plusieurs âmes séparées, celui‑ci jouirait au contraire d’une âme unique, immortelle et intellective. Contre les thomistes, le médecin Fernel (1554) refuse d’admettre que chaque âme (végétative, sensitive, intellectuelle) disparaisse pour laisser place à la suivante lors du développement du fœtus, selon la théorie de l’épigénèse, car « l’homme n’est point une beste brute, ny une beste brute une plante, autrement les especes des choses tomberoient dedans une grande confusion ». Réfuter ainsi Aristote permet de rejeter une communauté de nature entre homme, animal et plante. Tout en restant chrétienne, cette philosophie peine ainsi à situer le statut anthropologique de l’homme dans le cadre d’une psychologie aristotélicienne.
Malgré la prégnance institutionnelle du modèle aristotélicien, les conditions du discours sur l’animal et la plante commencent à changer radicalement au XVIe siècle, alors que l’histoire naturelle connaît d’importants développements (Dannenfeldt, 1968 ; Findlen, 1994 ; Olmi, 1992 ; et pour un état des lieux historiographique : Glardon, 2006). Les discussions sur l’âme et le monde naturel s’ouvrent à d’autres influences philosophiques, qui défient l’anthropocentrisme du discours traditionnel. Pline et Sextus Empiricus soulignent la bigarrure du vivant pour annuler toute possibilité de penser par genres et par espèces. Quant aux sources platoniciennes et néoplatoniciennes, qui proposent une cosmologie imprégnée d’éléments théurgiques, hermétiques et magiques, elles inspirent un nouveau type de philosophie de la nature porté par Cardan, Telesio, Campanella ou Della Porta. Fondée sur les liens occultes de sympathie et d’antipathie régissant l’univers, cette philosophie développe un intérêt passionné pour les « singularités » animales et botaniques, qui perturbent l’ordre du vivant. Elle place les phénomènes praeter naturam, au‑delà de la nature, au centre de sa réflexion. Deux innovations de la période renaissante, les grandes Découvertes et l’imprimerie, ajoutent à cet ébranlement épistémologique : sous l’afflux de textes mis en circulation mais aussi d’animaux et de plantes auparavant inconnus, la remise en cause des classifications prend un tour inédit, d’autant que les créatures incongrues qu’on découvre invitent à porter un regard neuf sur animaux et plantes familiers.
Le XVIIe siècle précipite le démantèlement du système aristotélicien. Divers courants de pensée concurrents vont ainsi accentuer la crise du modèle anthropologique traditionnel, entraînant une réévaluation, négative ou positive, de la nature animale et végétale. On en distinguera deux.
Tout d’abord, si Van Helmont avait déjà contesté son âme au végétal, Descartes pousse encore plus loin la « désanimisation » du monde vivant en privant l’animal de toute activité psychique et même de sensation (Pichot, 1993). C’est la fameuse thèse de l’animal-machine, déjà défendue par Pereira en 1554, qui va donner à une question ancienne – les animaux pensent‑ils ou non ? – une brûlante actualité polémique. Si les animaux y perdent leur âme, a fortiori les végétaux. En spiritualisant l’âme, réduite désormais à son attribut, la pensée, et libérée de toute fonction organique, Descartes élimine en effet ce qu’Aristote appelait âmes végétatives et sensitives, pour les réduire à des forces mécaniques agies par la puissance ouvrière de Dieu. En somme, là où Aristote psychologisait le monde vivant, Descartes le mécanise et semble sanctionner définitivement la séparation entre vie et pensée. Comme l’avaient déjà proposé les Stoïciens, la ligne de partage essentielle passe désormais entre les êtres qui ne pensent pas et qui sont confinés à la matérialité du corps (res extensa) – animaux et végétaux-machines – et le domaine spirituel du cogito2.
Dans le même temps, certains revalorisent ce qui avait été dénigré : soit ils remettent l’homme à sa « juste » place, et le ravalent au niveau de l’animal ou de la plante ; soit ils élèvent les deux règnes inférieurs. L’apport commun de ce groupe de penseurs hétérogènes, que par convention on nomme « libertins érudits », prend donc pour sa part la forme d’une rupture décisive avec la conception théologique de l’homme, du monde et de Dieu. Ces libertins sont marqués par la philosophie de la nature « pansensiste » de Campanella et par des courants philosophiques antiques concurrents de l’aristotélisme, à l’image du scepticisme.
La place controversée accordée à l’animal et au végétal dans la grande échelle du vivant à l’époque pré-moderne engage ainsi des enjeux épistémologiques et éthiques subversifs, mettant aux prises tenants de l’ordre aristotélicien, nouveaux philosophes de la nature, théologiens, dogmatistes cartésiens et fauteurs de troubles libertins, ainsi que tous ceux qui, à l’instar de La Fontaine, les fréquentent. L’étude de ces rapports de force permettra de contribuer de manière originale à l’histoire de la philosophie, de la philosophie naturelle et de la psychologie au sens d’Aristote, en focalisant la réflexion sur la question de la communication.
______________________________
- Selon Vidal (2006), Descartes réalise là l’opération la plus radicale de la réforme mécaniste, et concourt à la transformation du champ même de la psychologie. Dans le cadre aristotélicien, elle était une science du vivant, une métadiscipline englobant aussi bien la botanique, la zoologie que l’anthropologie. Mais dès lors que l’âme cesse d’être la forme de tout corps vivant pour devenir l’esprit, mens, ou ce qui, en l’homme, pense, la psychologie devient une branche de l’anthropologie.
Stratégies communicationnelles
Le vivant forme‑t‑il ou non un continuum ? Ses classes sont‑elles perméables ou étroitement cloisonnées ? Les traits définitoires des plantes, animaux et hommes se combinent‑ils ou s’excluent‑ils ? Si cette question de communication ontologique doit être abordée d’un point de vue littéraire, c’est qu’elle est aussi linguistique. En témoignent les deux acceptions du verbe « communiquer », qui prend, à la fin du XIVe siècle, le sens d’ « être en rapport mutuel, en communion avec quelqu’un », et à partir XVIe siècle connaît une nouvelle extension, « transmettre une information ». L’enquête sur l’être propre aux différentes espèces renvoie ainsi d’une part à leurs moyens de manifestation et d’expression. D’autre part, elle implique une réflexion sur les moyens de représenter ces échanges et de les diffuser, que ce soit à travers le livre (éventuellement illustré), ou les choix génériques, linguistiques (latin vs français) et stylistiques des auteurs. Enfin, cette interrogation sur le discours n’est pas seulement thématique mais aussi formelle. Une longue tradition a utilisé les divers modèles du vivant pour penser la dispositio et l’elocutio d’un discours viable.
L’enquête déploiera ainsi son questionnaire sur plusieurs niveaux : quelles sont les conditions du partage entre l’homme, l’animal et la plante ? Et celles entre l’auteur et ses lecteurs, dès lors que le texte est le lieu ultime qui atteste d’une rencontre avec les autres êtres vivants ? Qu’en est‑il de la possibilité d’accéder à une expérience non-humaine du monde, et des moyens discursifs mis en œuvre pour représenter un point de vue relevant d’une radicale altérité ? Et comment inversement conçoit-on le fonctionnement du discours, voire de la langue, par référence organique aux trois formes humaine, animale et végétale, ainsi qu’à la notion d’un liber naturae ? Enjeux épistémologiques et poético-esthétiques se mêleront ainsi étroitement.
- Un défi épistémologique: Le statut accordé à l’animal et au végétal soulève d’abord le problème de la réalité : est‑elle la même pour une mouche, une mandragore ou un évêque ? Faut‑il admettre trois univers distincts, dont l’un ne serait accessible qu’à l’homme par la conscience, ou faire l’hypothèse d’un même monde appréhendé de deux, voire trois, manières différentes ? L’au‑delà de l’humain demeure par définition inaccessible, donc indicible (Uexküll, 1934). Comment alors échapper au conflit aporétique entre conscience aiguë de l’altérité et incapacité à la concevoir autrement qu’au filtre et avec les outils linguistiques de sa propre espèce ? Pour Montaigne, qui fait de cette tension un argument central, « il s’agit avant tout de montrer l’impossibilité à l’homme d’imposer une signification à la création (ou à la nature) à partir de lui‑même » (Gontier, 1998). Or la démonstration de cette impossibilité s’avère elle‑même impraticable et ne peut s’énoncer que sur le mode du probable. De cette difficulté épistémologique rend compte le premier trope d’Aenésidème, largement diffusé dès la fin du XVe siècle via les œuvres de Diogène Laërce et Sextus Empiricus. Selon ce mode d’argumentation, aucun critère ne permet de décider si la représentation d’un être humain est plus proche de la réalité que celle d’un animal, sujet perceptif aussi qualifié que nous, et cette mise en équilibre des apparences entraîne la suspension du jugement. Mais comment appliquer cet argument, sinon par le biais d’une projection fictionnelle, puisque l’accès à la perception de la bête nous est refusé et que cette dernière se dérobe comme objet d’interprétation ? A fortiori lorsqu’il s’agit d’imaginer le monde du point de vue d’une plantule. Certaines fictions explorent un point de vue animal ou végétal : Ottmar Nachtgall (1522) fait discourir un cochon sur sa propre existence, tandis que Cyrano de Bergerac (1657) feint de laisser la parole à un chou qui dit « je », à l’instar des humains – scènes de ventriloquie plutôt qu’invention d’un langage singulier. Concéder à l’animal et au végétal des moyens d’expression se fait toujours par la médiation du modèle humain. Mais cette parole nécessairement humaine n’échappe pas à la perturbation causée par le détour animal ou végétal.
- La Babel du vivant : Dans cette logique de relativisation de la connaissance humaine, le langage joue un rôle clé. C’est la voix, l’émission de sons, qui séparerait l’animal du végétal et tracerait la frontière du sensible, tandis que c’est la parole qui constituerait la ligne de démarcation entre homme et bête, selon Aristote. Mais cet anthropocentrisme prête flanc à deux types d’attaque : soit on juge égales, voire supérieures, les facultés des autres créatures (la mandragore crie, voire parle ; le perroquet rit avec, voire contre les hommes), soit on dénonce l’incapacité des hommes à comprendre un autre langage que le leur. Montaigne par exemple reconnaît aux bêtes qui n’ont pas de voix « quelque autre moyen de communication : leurs mouvements discourent et traictent », tandis que Cyrano de Bergerac met en garde son lecteur, dans la lignée du pansensisme campanellien : « Si vous me demandez comment je sais que les choux ont ces belles paroles, je vous demande comment vous savez qu’ils ne les ont point, et que tel, par exemple, à votre imitation ne dise pas le soir en s’enfermant : “Je suis, M. le Chou Frisé, votre très humble serviteur, Chou Cabus [une espèce de chou]” ». Les réflexions zoocentristes de Montaigne se prolongent ainsi en expériences de pensée phytocentristes, où l’imaginaire supplée aux silences de cette parole empêchée. Les arguments utilisés pour promouvoir un règne sont transposés en faveur de l’autre.
- Un défi poétique : animalité, végétalité et littérarité : En cherchant à percer le mystère de la communication animale ou végétale, le texte fait retour sur ses propres possibilités expressives. En dénonçant le caractère contingent des classifications du monde naturel, et plus fondamentalement en laissant soupçonner une expérience du réel à laquelle nul savoir établi n’a accès, l’altérité animale ou végétale fait travailler la langue des hommes et la fait réfléchir sur elle‑même – sur ce qu’elle aurait de singulier par rapport aux modes de communication des autres êtres vivants, et sur sa capacité à rendre les mots mieux adéquats à leurs référents. En cela, le discours sur l’animal et la plante a partie liée avec l’émergence du fait littéraire : car l’étrangeté énigmatique qu’ils incarnent peut dépayser la langue à la manière des dispositifs stylistiques, qui manifestent « l’écart interne par lequel la langue sans cesse s’écarte d’elle-même » et « se désidentifie » (Jenny, 2005, dont les propositions théoriques seront utiles à notre projet). L’altérité animale ou végétale entrerait ainsi en résonnance avec l’autre de la langue, qui « s’estrange » à elle-même par la puissance d’innovation linguistique dont l’usage littéraire est porteur.
Dernier signe de l’intrication entre ontologie et poétique, la comparaison joue un rôle déterminant dans tous les textes de notre corpus : heuristique ou ornementale, elle brouille les frontières du vivant mais aussi, on le verra, les limites entre ce vivant et le langage.
II. 3. Trois études de cas
Sous-projet A : La rencontre des hommes et des animaux dans les récits de langue française au XVIe siècle (thèse)
C’est à la Renaissance que le terme « animal » détrône peu à peu face celui de « bête » en vigueur jusqu’alors. Ce changement en dit beaucoup sur les modifications des rapports entre les hommes et les animaux qui s’opèrent au XVIe siècle, rapports qu’on étudiera ici autour du motif précis de la rencontre entre homme et animal, telle qu’elle apparaît dans les textes narratifs. Cette mise en récit, qui signale l’importance accordée à ce moment de mise en contact de deux êtres, en fait une occasion privilégiée pour penser la question de l’identification et de la désignation de l’autre, ainsi que la difficile conciliation de leurs langages. La problématique générale du projet trouve dans de tels textes un lieu d’expression particulièrement riche. D’une part, la question du heurt avec les possibles langages animaux se double d’une tension entre deux langues humaines : ces récits sont composée en français à un moment où la littérature nationale se détourne du latin, y compris dans des textes scientifiques. D’autre part, cet espace de représentation apparaît fortement polarisé.
Au XVIe siècle, les relations qu’entretiennent l’homme et l’animal participent d’une double dynamique presque contradictoire : une relation inédite, qui émerge avec la découverte d’animaux jusque‑là inconnus, fait face à une relation familière construite par des interactions permanentes. Or cette logique duelle se retrouve au niveau littéraire puisque si ces relations s’expriment dans un espace inédit, celui acquis peu à peu par la langue française dans la production du récit, l’imaginaire culturel reste entièrement structuré autour d’un réseau d’animaux symboliques sans cesse ressassés, hérités à la fois des écrits bibliques, des méthodes de la pédagogie scolastique, du bestiaire foisonnant des récits médiévaux et des traditions populaires – les uns et les autres également retravaillés à partir de la matière antique largement traduite et redécouverte à la Renaissance (d’un côté : Virgile, Ovide, Ésope, Hésiode, Apulée ou Lucien ; de l’autre : Aristote, Élien, Pline ou Plutarque). La rencontre réelle avec l’animal est donc doublement médiatisée : par les « rencontres » culturelles qui l’informent et la production textuelle qui la construit. Enfin, le récit est ultimement la seule preuve qui demeure de la rencontre entre homme et animal. Il est « relation » au double sens du terme en moyen français – celui, testimonial, de « récit » et celui, logique, de « rapport entre deux choses ». Or la possibilité qu’il relève de la fiction et sa dimension temporelle ajoutent deux angles de réflexion cruciaux aux solidarités notionnelles déjà impliquées par notre problématisation du concept de « communication ».
En outre, le motif a l’intérêt de traverser des strates discursives variées. De la simple mention en forme d’anecdote jusqu’aux romans les plus élaborés, tout un corpus se développe autour de rencontres qui vont d’une fréquentation allant de soi – et qui validerait sans autre débat des catégories ontologiques pré-établies – à une confrontation perturbatrice comme celle que Jean de Léry vit avec un « monstrueux et espouvantable lezard » (1578) : « cestuy‑là avoit prins aussi grand plaisir de nous regarder que nous avions eu peur à le contempler ».
D’un point de vue chronologique, ce corpus s’étendra du début du XVIe siècle, lorsque le français acquiert une nouvelle légitimité littéraire dans l’acte de raconter, jusqu’à la rupture décisive induite par la définition cartésienne de l’animal-machine. Lors de cette première étape, divers types de textes ont été distingués, dans un continuum qui part d’une parole se voulant objective, passe par une parole plus engagée personnellement, et rejoint la fiction narrative. Ils formeront 7 pôles : (1) la production scientifique : histoires naturelles et savoir zoologique (à des fins de comparaison, corpus tant latin, avec Pierre Gilles et Charles de L’Ecluse, que français, avec Rondelet et Paré) ; (2) la production juridique (les procès d’animaux, commentés par Camemarius) et théologique (notamment la tradition hagiographique – Antoine et le cochon, François et les oiseaux, Jérôme et le lion) ; (3) la littérature agronomique (tradition des maisons rustiques avec Serres, Estienne, Liébault) et cynégétique (de Thou, du Fouilloux) ; (4) la littérature viatique (Léry, Thevet, Belon) ; (5) la poésie (Marot écrit pour Hedart, le cheval du secrétaire du duc de Guise, Ronsard pour Courte, la chienne de Charles IX) ; (6) le récit personnel (Montaigne, Pasquier) ; (7) les récits fictionnels (Rabelais, Des Périers, Aneau, Alector ou le coq). L’ampleur du corpus est compensée et justifiée par le caractère très localisé des scènes de rencontre et par l’objet bien circonscrit de l’enquête : comprendre les modalités, poétiques et épistémologiques, de la restitution et de la transmission d’une rencontre par le biais d’un récit.
Sous-projet B : Prière à la plante : fortune et infortunes de la botanique magique à la Renaissance
Si le chasseur de la Renaissance n’adresse plus de prière à l’animal qu’il rencontre, il n’en est pas de même du magicien-cueilleur. Dans l’histoire complexe des usages magiques de la plante, il existe, dès l’Antiquité une « conception naturaliste, qui [lui] reconnaît une personnalité » et invite à l’invoquer comme un être puissant, doué d’une volonté propre, pour obtenir ses faveurs (Delatte, 1938). Pour ceux qui savent jouer de la « magie verte » et user des mots et des rituels appropriés, certains végétaux ont le don d’ouvrir des passages entre puissances occultes et monde humain. Ils constituent une flore magique et astrologique, à distinguer de la flore mythologique et de la flore des rites de la religion civique (Ducourthial, 2003), et toute une littérature s’en empare, née dans le creuset de la culture gréco-romaine et marquée par l’influence de pratiques en usage au Moyen-Orient et dans l’Égypte hellénisée.
Si cette prière constitue la plante en interlocutrice, à qui s’adresse‑t‑on quand on l’interpelle (Lieutaghi, 2015) ? N’est‑elle que la vectrice de forces – astrales, divines ou démoniaques – qui la dépassent, ou est‑elle prise en compte pour elle‑même ? Comment distinguer sa place parmi la multiplicité des interlocuteurs mobilisés ? Dès l’Antiquité, un personnel très riche est mis à contribution pour multiplier les chances de succès : divinités, personnages de la Torah et des Évangiles, figures mal identifiées, peut-être imaginaires, comme Mesenkriphi. Ces formules traversent les siècles (Ducourthial, 2003), ce qui pose la question de la longue durée. Quant au vocatif, institue‑t‑il la plante comme une singularité dotée d’une intériorité, avec laquelle le cueilleur nouerait des relations personnelles ? Quel est le statut de l’invocation – établit‑elle un vrai dialogue, ou bien propose‑t‑elle un simulacre de communication ?
Nulle réponse possible sans accès à la performance vivante du magicien. En revanche, les formules incantatoires capturées par des textes sont les traces fragmentaires de cette rencontre sensible. On se propose ici d’examiner comment elles ont traversé le temps jusqu’aux éditions de l’Europe de la première Modernité, et sous quelles conditions elles furent alors jugées licites par la médecine institutionnalisée ainsi que par l’Église, qui les condamne ou les christianise. Il s’agira de mesurer les enjeux d’un transfert culturel pris entre fidélité au bagage antique et orthodoxie religieuse, pratiques populaires et émergence d’une « science » botanique. On réfléchira plus spécifiquement en termes de régime de production des imprimés. L’enquête philologique, qui se substitue à l’ethnographie des rituels, se développe sous deux angles : réception imprimée du corpus antique intégrant des éléments de botanique magique, et productions de textes originaux, voire littéraires sur le même sujet.
Quels sont les textes passés retenus pour la publication ? A quelles censures ou remaniements les incantations sont‑elles soumises ? Quels préjugés idéologiques gouvernent ces transformations et à quels horizons d’attente ces imprimés doivent‑ils s’adapter, en comparaison avec la production manuscrite ? Quelles marques enfin laissent‑ils dans la culture contemporaine ? Sur ce point, on fera l’hypothèse que c’est dans la poésie de la nature, celle d’un Du Bartas ou d’un Ronsard, que la voix lyrique s’impose comme le vecteur inédit de la prière à la plante. On examinera en particulier le destin éditorial du Liber de vettonica, de l’Herbarius du pseudo-Apulée (ive siècle), et d’une compilation qui les réunit, le Tractatus de herbis (XIVe siècle). Une de ses versions françaises connaît plusieurs éditions imprimée entre 1498‑1534 : elles perpétuent la prière adressée à l’ « Herbe Bétoine » associant Esculape au Dieu de l’Église. Mais ces traités ne survivent pas à la concurrence didactique des herbiers modernes, qui développent des descriptions et illustrations beaucoup plus précises.
En même temps, la redécouverte admirative par les humanistes des sources anciennes, où magie, astrologie et démonologie jouent un rôle essentiel, exerce alors une influence décisive sur l’essor de l’occultisme et la défense de la magie naturelle. C’est dans ce cadre qu’il faut replacer le développement de la « théorie des signatures », qui explicite les principes de la pharmacopée magique. Botanistes hermétistes et naturalistes rêveurs érigent l’analogie en système du monde. Cependant, l’historienne Agnès Arber a souligné le caractère cohérent mais marginal de ce courant. Les meilleurs botanistes « orthodoxes » du XVIe siècle (Bock, Turner, Dodoens, Bauhin) font peu de cas de la doctrine des signatures ou de l’astrologie. Pourrait-on dire que s’amorce dans ce cas précis un partage entre savoir institutionnel, assuré de détenir la vérité, et savoir magique qu’on juge entaché de superstitions mais qui, dans les campagnes, continue à nourrir de très nombreuses croyances jusqu’au début du xxe siècle ? Le projet se concentrera ainsi sur une période clé, où coexistent des temporalités et des cultures hétérogènes, – celle où l’on veut jouir des pouvoirs de la plante sans rien lui devoir ; celle où l’on est encore un peu son frère dans l’unité du monde, le tout traversant différents régimes de discours dont l’on s’attachera à cartographier les relations. Les résultats prendront la forme d’articles scientifiques.
Sous-projet C : Formes du vivant et modélisation du discours
Un très riche imaginaire de l’écriture et de la lecture permet aux XVIe et XVIIe siècles de penser le rapport au texte comme un rapport à une réalité non seulement humaine mais paradoxalement également végétale ou animale. La célèbre roue de Virgile, élaborée en un système complet au Moyen Âge et qui reste, pour la première Modernité, le modèle même de représentation de l’écriture, fait correspondre aux trois sortes de styles connus les univers de référence humain, animal et végétal. Au style humble, les pâtres, les moutons et les hêtres ; au style moyen, les paysans, les bœufs et les arbres fruitiers ; au grand style, les guerriers, les chevaux, les lauriers ou les cèdres (Curtius, 1956). Il reste que l’homologie fortement ancrée entre œuvre et organisme diffère radicalement selon qu’elle se réclame d’un modèle botanique, zoologique ou humain. Il s’agit ici d’examiner la concurrence entre ces différentes formes, la spécificité de chacune d’elles, et la manière dont elles permettent de distinguer et de conceptualiser des discours et des poétiques.
On se demandera d’abord ce qui fait le propre du modèle végétal, a priori dominant tant pour nommer les supports d’écriture – livre, book, Buch – que pour désigner les genres – de l’ « arbre fourchu » (un type de lai) au « bocage » (1550 en ce sens), « foresteries » (1555), « silves » (1671). Grâce à ses caractéristiques – étagement et ramification des branchages, luxuriance, croissance continue – il l’emporte alors sur d’autres modèles comme le corps humain, qui « n’est pas extensible dans une seule et même direction » (Klapisch-Zuber, 2009). Il paraît donc particulièrement apte à rendre compte de la langue ou de l’écriture dans leur genèse et leur dynamique. Et il permet de décrire les excès de ce mouvement : ce qui dépasse, déborde et s’épand sur les bas-côtés de l’œuvre, hors d’une composition mesurée et normée, relève dans l’histoire lexicale du floral – « fleurons » (en typographie, 1680), « vignettes », qui vient de vigne (1454). Le végétal illustre la fécondité de l’excentrique, du marginal mais aussi l’ineptie du superfétatoire : on condamne le maniérisme d’un « style fleuri » (1680). Du fait de sa transformation par l’homme (l’agriculteur, le bûcheron, ou le vigneron), il permet aussi de désigner le travail effectué par poète et écrivain pour domestiquer la nature : le poème est un arbre que l’on « taille », le vers une « branche » que l’on « césure ». Le paradigme végétal permet ainsi d’évoquer simultanément la nature et l’art, concepts avec lesquels on ne cesse de penser la littérature dans la première Modernité, de même que la langue vulgaire ne saurait s’illustrer qu’à force de greffes et transplantations.
On s’interrogera en retour sur ce qui favorise au contraire le recours à la structure homothétique de l’animal, privilégiée par exemple chez Platon, pour qui tout discours « doit être composé comme un être vivant ; avoir un corps qui lui soit propre, une tête et des pieds, un milieu et des extrémités proportionnées entre elles et avec l’ensemble » (Phèdre, 264C). De même, Aristote compare l’unité du poème tragique à celle de l’organisme animal (Poétique, 7, 50 b), dont la croissance est fermée, à la différence de la plante, où elle se confond avec la vie. Le projet fera l’hypothèse que la plante devient un opérateur de décentrement, alors que le règne animal, plus facilement hiérarchisable, permet d’ordonner axiologiquement les espèces (ainsi la typologie des rimes qui mène de la « rime goret » à la « rime léonine »). Plus proche de l’homme par le fait qu’il se meuve et produise des sons, l’animal permet de désigner, à travers certaines images de l’Antiquité, réactualisées à la Renaissance et à l’Âge classique, la pratique de l’écrivain (abeille butinant, araignée confectionnant sa toile) ou d’interroger sa capacité lyrique (le poète en oiseau chanteur, rossignol ou alouette).
Ces hypothèses explicatives seront confrontées à l’examen d’un large corpus de textes réfléchissant aux lettres et aux savoirs « littéraires » (voir premier relevé en bibliographie), dont le dépouillement en termes de paradigmes métaphoriques reste à mener, et qui permettra de déterminer des idiosyncrasies et de distinguer sur la longue période envisagée des moments spécifiques où un paradigme concurrence l’autre.
L’approche diachronique globale sera assurée par J.‑Ch. Monferran et prendra la forme d’articles ou de communications. En revanche, la thèse de Florian Quentin mène une enquête étroitement synchronique qui porte sur le « métadiscours dans la poésie et la poétique des premières années de la Pléiade : représentations végétales, animales et humaines, 1549‑1555 ». Le renouvellement profond du regard porté sur la poésie durant cette période implique une mutation de ses représentations et des mots employés pour la désigner, dont nombre d’images végétales, animales ou humaines. En quoi les auteurs de la Pléiade qui héritent du riche métadiscours antique, fondé souvent sur ces analogies, le prolongent‑ils ou le transforment‑ils ? Dans quelle mesure rompent‑ils ou poursuivent‑ils avec le métadiscours non moins riche de leurs prédécesseurs en langue vulgaire ? Quel est le sens de la distinction des règnes dans ce métadiscours et l’évolution de leur répartition, alors que les expérimentations se succèdent rapidement et qu’une nouvelle poétique se met en place ? Le référence végétale a‑t‑elle tendance à reculer au profit des autres univers ? Y a‑t‑il enfin des idiosyncrasies propres à certains auteurs, et qu’est‑ce qu’engage alors le fait, pour parler de sa pratique, de recourir à un domaine plutôt qu’à un autre ? Pour mener à bien cette étude originale, on peut s’appuyer sur les travaux de C. Trotot portant, dans une perspective différente, sur la métaphore à l’époque de la Pléiade, comme sur les perspectives ouvertes par M. Jeanneret et son Perpetuum mobile quant à la conception métamorphique des œuvres à la Renaissance.
III. L’équipe
Prof. Dr. Dominique Brancher : D. Brancher a déjà participé à de nombreux projets scientifiques. Son travail privilégie l’histoire et les enjeux des relations entre des œuvres considérées comme « littéraires » et différents savoirs – théologie, droit, philosophie et plus particulièrement médecine, ce dont témoigne un récent ouvrage, Équivoques de la pudeur. Fabrique d’une passion à la Renaissance (Droz, 2015). Ce travail a conduit la requérante à porter une attention particulière à la botanique renaissante, objet d’un livre paru en octobre 2015 chez Droz : Quand l’esprit vient aux plantes. Botanique sensible et subversion libertine, XVIe et XVIIe siècles. Le présent projet s’inscrit dans le prolongement de cette enquête, notamment en matière de réflexion sur les frontières entre les espèces, tout en leur apportant deux infléchissements importants : la recherche est ici collective et prend en compte l’ensemble du vivant. D. Brancher coordonne l’ensemble du projet et assure deux tâches particulières : outre l’édition critique du Rare et curieux Discours de la plante appelée mandragore de l’apothicaire Laurens Catelan (1638), premier traité consacré tout entier à cette plante3, elle se concentrera sur la question de la prière aux plantes (sous-projet B), relevant d’un corpus absent de ses travaux antérieurs, celui de la botanique magique et astrologique, dont il s’agira d’explorer le devenir à la Renaissance.
Lien vers sa page personnelle.
______________________________
- Publié à compte d’auteur à Paris en 1638, ce bref traité n’a connu qu’une édition et n’a jamais été republié depuis. Il fait valeur de somme des savoirs magiques et pharmacologiques sur la mandragore.
Prof. Dr. Jean-Charles Monferran : Après des premiers travaux sur la poésie scientifique à la Renaissance, J.‑Ch. Monferran s’est principalement intéressé à la manière dont la littérature à l’âge de la première Modernité cherche à se constituer en discipline, rassemblant et organisant un savoir en langue vulgaire, distinct de celui des lettres latines, et comparable à certains égards à celui d’autres savoirs moins troublés, alors en train de se configurer en langue vernaculaire (médecine, astronomie, mathématiques). En témoigne, à la suite de travaux d’éditions personnels ou collectifs, l’ouvrage de synthèse paru chez Droz en 2011 (L’École des Muses : les arts poétiques français à la Renaissance (1548‑1610)). Dans cette perspective et à la suite de la direction avec M. Jourde d’un collectif sur la métalangue littéraire (Le Lexique métalittéraire français (XVIe-XVIIe siècles), Droz, 2006), il a entamé des recherches sur la manière dont les traités portant sur le vers, du XVe au XVIIe siècle, empruntent leurs mots aux organismes vivants (humains, animaux et végétaux), s’interrogeant sur le sens de ces transferts. Dans le cadre du projet présenté, J.‑Ch. Monferran travaille plus spécifiquement sur la modélisation du discours et les formes du vivant (sous-projet C).
Lien vers sa page personnelle.
Florian Quentin : Spécialisé dans la littérature mondaine des années 1660, Florian Quentin participe, de 2015 à 2016, au projet d’édition critique en ligne des Nouvelles Nouvelles de Donneau de Visé (www.nouvelles.nouvelles.fr) à l’Université de Fribourg (Suisse) tout en rédigeant, sous la direction de C. Bourqui, son mémoire de recherche consacré à un texte inédit du XVIIe siècle intitulé Le Démêlé de l’esprit et du cœur qui mêle vulgarisation du savoir scientifique de l’époque et satisfaction des attentes d’un public exigeant. Sa double formation universitaire – en lettres (littérature et philosophie) et en sciences (biologie animale et végétale) – ainsi que ses connaissances botaniques de terrain (certificat avec distinction auprès de la Société Botanique Suisse en 2012) l’ont conduit à s’intégrer à ce projet interdisciplinaire en septembre 2016. Sa recherche étroitement synchronique (sous-projet C) porte sur le métadiscours humain, animal et végétal dans les arts poétiques et dans la poésie des premières années de la Pléiade (1548-1555).
Augustin Lesage : Lauréat d’une bourse de début de thèse à l’université de Bâle, A. Lesage s’engage dans un doctorat sur la rencontre des hommes et des animaux dans les récits de langue française au XVIe siècle (sous-projet A). Son mémoire de recherche, réalisé à l’ENS de Lyon en 2013, sous la direction de M. Jourde, portait déjà sur la question animale puisqu’il avait pour sujet l’unique roman animalier écrit par un humaniste lyonnais : Alector de Barthélemy Aneau. A. Lesage a complété sa formation par des études de philosophie à l’université de Paris-Ouest Nanterre. Il a été ingénieur de recherche au CNRS et a participé à d’importants projets d’édition scientifique, en particulier auprès des éditions Honoré Champion. Professeur agrégé de Lettres modernes, il a enseigné dans le secondaire et dans le supérieur, notamment à l’université de Lyon III.
Sophie Avosti : Étudiante de master en littérature française et anglaise à l’université de Bâle, s’occupe de la gestion informatique du projet.